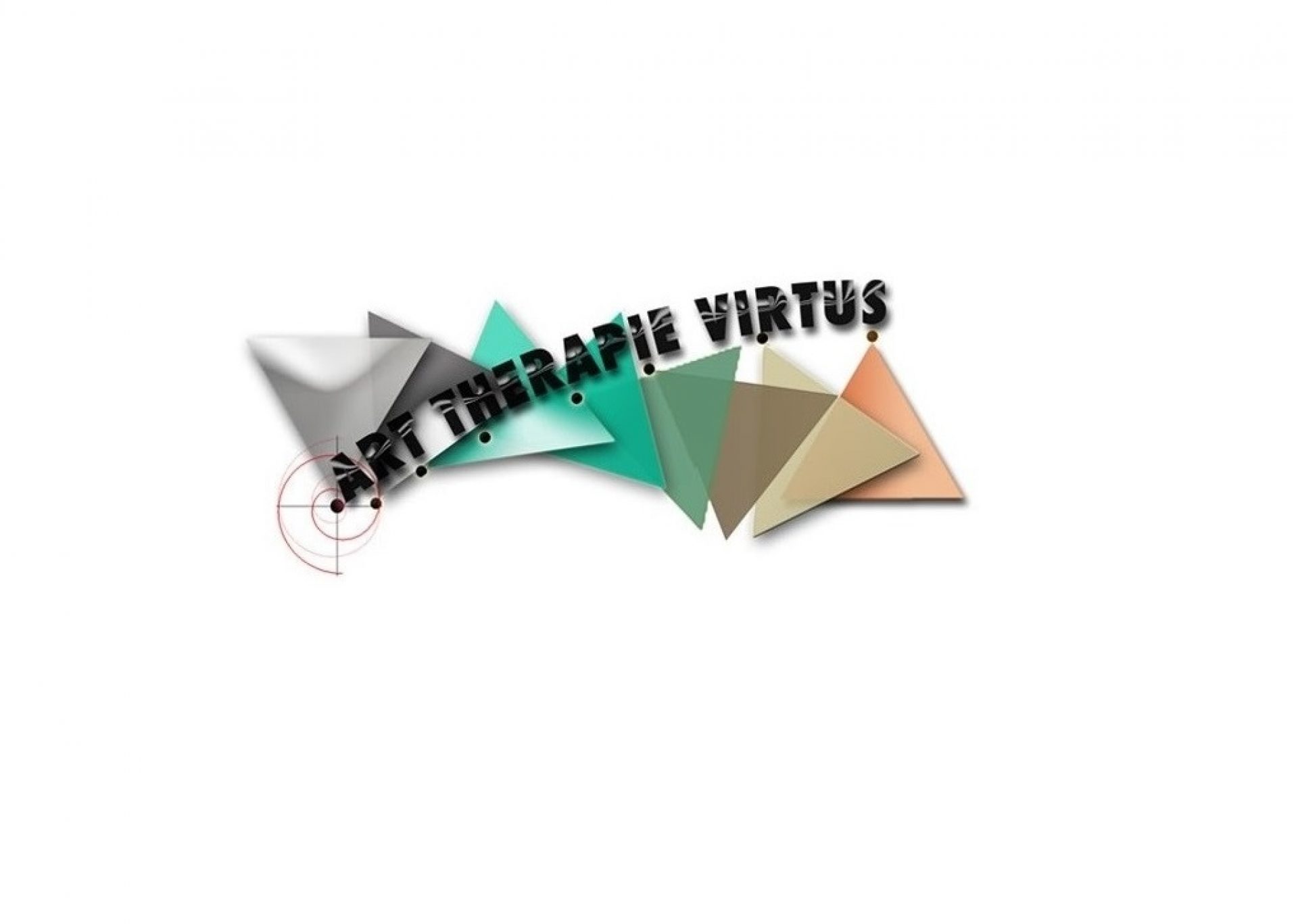Deux œuvres d’Unica Zürn seront présentées lors de l’exposition L’art pour l’art, La Collection Sainte-Anne du 29 mai au 28 juillet 2015 au Musée Singer-Polignac.
 Berlin, juillet 1916 – Paris, octobre 1970
Berlin, juillet 1916 – Paris, octobre 1970
Unica Zürn
Sans titre
9 novembre 1961
Encre noire sur papier
50 x 67 cm
© crédit photographique
Collection Sainte-Anne
inv. n°0273
Pour aller sur le site du Centre d’Étude de l’expression, cliquez sur le dessin
 La dédicace de la page de garde.
La dédicace de la page de garde.
“Son père est le premier homme dont elle fait la connaissance…”
page 36
Elle décrit ce qui s’est passé avec son frère.
“En ce mois de juillet tranquille et brûlant, par un après-midi où l’orage menace, son frère se faufile dans sa chambre et la jette sur le lit. Le visage comme pétrifié et gardant un silence inquiétant, il déboutonne son pantalon et lui montre entre ses jambes l’objet qui s’est allongé. Elle est tourmentée par la curiosité et l’angoisse. Elle sait ce qu’il veut faire. Mais elle le méprise. A ses yeux il n’est qu’un jeune sot de seize ans. Elle se défend de toute son énergie, mais il est plus fort qu’elle et elle ne peut plus se dégager. Elle le méprise parce qu’il est trop jeune. Il se jette sur elle et il lui plante son “couteau” (comme elle l’appelle) dans sa “blessure”. Haletant il pèse de tout son poids sur son petit corps. Il s’agite sur elle en un rythme accéléré. Elle sent une douleur cuisante et rien d’autre. Elle est honteuse et déçue. De s’abandonner la nuit au cercle sombre des hommes autour de son lit est suffisamment excitant et voluptueux pour renoncer à cette misérable réalité que lui offre son frère. Après un moment qui lui paraît un siècle, son frère roule du lit et sort sans un mot. Il revient quelque temps après, rouge de colère. « Si tu en parles à mère, je te tuerai. » Elle le regarde, muette et méprisante. Elle est indignée et furieuse. Cet événement fait du frère et de la sœur des ennemis mortels. Elle a envie d’assassiner son frère. C’est seulement parce qu’il est plus fort qu’elle qu’il a réussi ce qu’il voulait. Elle lui souhaite tout le mal possible. Elle va songer à la manière de le faire mourir à petit feu.”
L’art thérapie : un art qui soigne et qui s’expose à Toulouse
 Qu’arrive-t-il à l’art lorsqu’il s’affranchit de tout acte marchand pour se mettre au service de la santé ?
Qu’arrive-t-il à l’art lorsqu’il s’affranchit de tout acte marchand pour se mettre au service de la santé ?
A l’Hôtel Dieu de Toulouse, actuel siège administratif du CHU de la ville, se tient une fois par an une exposition d’un genre assez particulier, voire atypique pour les vielles briques de cet ancien hôpital Jacquaire. L’art thérapie sort provisoirement de son atelier situé à l’hôpital de Purpan, pour nous toucher et nous interroger dans notre humanité.
Découverte insolite et inattendue
« Enfin de l’art » m’a-t-on dit en me recommandant l’exposition. Forte de ce bouche à oreille élogieux, et quoique légèrement sceptique quant à un art produit par des patients, des « non-artistes », je balade ma curiosité à travers la cour de l’hôtel-Dieu. Après m’être ingénument perdue au musée de la médecine, (c’était presque ça, mais pas encore tout à fait la bonne pioche !), je passe devant la grande conque Jacquaire renversée. Aucune Vénus à la Botticelli n’est là pour en sortir. Elle est vide. La beauté sera-t-elle au rendez-vous ? A quoi va bien pouvoir ressembler cet art, produit dans le cadre d’une thérapie ? Je continue dans la direction qui m’a poliment été indiquée. Quelques marches plus loin, l’accueil est tenu par le personnel médical, sans blouses blanches. J’observe le registre ouvert. Au nombre de carrés divisés en triangles par une diagonale, je comprends que l’exposition est un franc succès. De salle en salle, de peinture en marionnettes, de contes en installations et sculptures de glaise, je suis surprise par l’atmosphère du lieu et de l’exposition. Un sentiment de « chez-soi » peu commun se dégage. Tout est agencé, mais rien ne semble rigide ou aseptisé. Les techniques et moyens d’expressions sont divers et variés, inattendus parfois ; le lieu et son contenu se répondent harmonieusement. Cher lecteur, que la visite commence. Qu’elle ressemble à un voyage intérieur !
L’art thérapie : un art qui soigne et qui s’expose
Qu’arrive-t-il à l’art lorsqu’il s’affranchit de tout acte marchand pour se mettre au service de la santé ?
A l’Hôtel Dieu de Toulouse, actuel siège administratif du CHU de la ville, se tient une fois par an une exposition d’un genre assez particulier, voire atypique pour les vielles briques de cet ancien hôpital Jacquaire. L’art thérapie sort provisoirement de son atelier situé à l’hôpital de Purpan, pour nous toucher et nous interroger dans notre humanité.
Découverte insolite et inattendue
« Enfin de l’art » m’a-t-on dit en me recommandant l’exposition. Forte de ce bouche à oreille élogieux, et quoique légèrement sceptique quant à un art produit par des patients, des « non-artistes », je balade ma curiosité à travers la cour de l’hôtel-Dieu. Après m’être ingénument perdue au musée de la médecine, (c’était presque ça, mais pas encore tout à fait la bonne pioche !), je passe devant la grande conque Jacquaire renversée. Aucune Vénus à la Botticelli n’est là pour en sortir. Elle est vide. La beauté sera-t-elle au rendez-vous ? A quoi va bien pouvoir ressembler cet art, produit dans le cadre d’une thérapie ? Je continue dans la direction qui m’a poliment été indiquée. Quelques marches plus loin, l’accueil est tenu par le personnel médical, sans blouses blanches. J’observe le registre ouvert. Au nombre de carrés divisés en triangles par une diagonale, je comprends que l’exposition est un franc succès. De salle en salle, de peinture en marionnettes, de contes en installations et sculptures de glaise, je suis surprise par l’atmosphère du lieu et de l’exposition. Un sentiment de « chez-soi » peu commun se dégage. Tout est agencé, mais rien ne semble rigide ou aseptisé. Les techniques et moyens d’expressions sont divers et variés, inattendus parfois ; le lieu et son contenu se répondent harmonieusement. Cher lecteur, que la visite commence. Qu’elle ressemble à un voyage intérieur !
6 totems
Installations cousues, décousues, qui mêlent tissus et assemblages d’objets, tels que des instruments de musique, des os, des perles en bois de bambou, fragments d’une forte matérialité aux couleurs vives, presque brutes et proches de la primauté d’un geste. On sent comme une aura de sacré derrière ces figures aux allures de totems. Drôles de génies, qui nous dominent légèrement par leur taille et qui gardent obstinément et systématiquement les bras ouverts, comme on accueille et embrasse, comme on s’expose à tout en s’ouvrant. Ils semblent venus nous saluer de cultures lointaines et proches des origines de l’Homme.
Les instruments, les maracas, les tambours, attendent immobiles, comme les potentialités d’un changement exprimé à l’état latent, celui du silence. Pourtant les baguettes sont posées sur les peaux tendues, comme une façon de dire : nous ne sommes pas dans une exposition traditionnelle, vous pouvez jouer. La sacralité n’est pas figée. Pourquoi pensez-vous que nous sommes là ? Une enfant ose s’essayer au hang un peu plus loin, un instrument de musique pour le moins original et métallique, inventé par deux suisses en l’an 2000.
Réminiscence platonicienne
Le théâtre d’ombres chinoises, fait défiler ses histoires comme on renoue avec le mythe de la caverne afin de mieux en sortir. A travers lui ce sont nos propres comportements que nous regardons pour aller vers plus de lumière. La parole muette, lue à l’écran, prend la voix de notre intériorité car elle n’épouse pas la personnalité d’un timbre phonique. La vidéo est animée par un travail touchant de sincérité, exprimé en mots naïfs, qui en essence nous caractérisent tous et abordent les questions de notre place dans la société, l’éloignement des êtres chers, la différence et ce décalage parfois trop grand entre ce que nous voulons être et ce que nous sommes, les peurs obscures qu’on affronte et avec lesquelles on vit. La vidéo se situe entre le registre du conte et l’expérience plastique, avec un arrière-goût du Petit Prince, explicitement présent dans d’autres salles.
En quittant le film, nous reconnaissons les marionnettes colorées qui ont servi pour la création des ombres animées. Suspendues en hauteur, elles sont comme des concepts à utiliser pour de prochaines créations, ou des masques que l’on a cessé de porter. Libre à chacun d’y apporter les sens qui le construisent.
Dans le rapport à l’art, il me semble qu’il faut parfois savoir revendiquer le droit à une hyper-subjectivité des perceptions. Chaque sensibilité est souveraine dans ce dialogue muet, à la fois avec l’espace et les matières transformées ou détournées en la manifestation d’un sens.
Sortir de l’espace conventionnel
Je ne veux pas parler de scénographie, mais la spatialité me semble ici essentielle. La disposition des différentes créations entre elles et en relation avec les éléments existants est une façon de mettre de l’ordre dans « le monde », comme on architecture le « vide » ou le foisonnement d’une pensée.
La circulation se fait librement, en ce sens qu’il y a plusieurs parcours permettant de passer d’un point à un autre, d’une création à une autre. La déambulation se fait sans véritable passage obligé, hormis le déplacement de pièce en pièce. Les recoins offrent des surprises, comme cette « petite » salle où l’on découvre des contes, écrits et illustrés de collages ou de peintures par les patients, ou encore l’ancienne sacristie où l’on peut s’asseoir le temps de vivre les interrogations proposées par l’art.
Le lieu tranche radicalement avec ce à quoi nous pouvons être habitués par les galeries et musées : les grands espaces vêtus de blanc, comme une volonté de faire abstraction de tout, sauf de ce qu’il y a à voir. Je pense ici particulièrement au Moma de Barcelone. Pur et blanc comme une détresse car l’on n’y trouve rien d’autre que soi-même où se raccrocher face à ce que l’art comporte de déstabilisant.
Dans la salle des colonnes, la symétrie est tantôt soulignée, tantôt contredite par l’installation des travaux dans l’espace. Les boiseries sont cirées, patinées par le temps, comme un vieil ordre féodal. Parmi les marques du passé flotte une noblesse oubliée dont subsistent encore de grands tableaux. Les pièces paraissent immenses, leur hauteur sous plafond est évidemment hors des normes actuelles. Parquets, briques aux joints bien creux, moquettes en damier marron-crème, tout est daté, et ne refuse pourtant pas le changement temporaire induit par la présence de l’exposition. L’ancienne chapelle est envahie de marionnettes. Le Petit Prince trône sur l’autel, et les enfants sont invités à se faire photographier en sa compagnie. Un peu en retrait, l’ancienne sacristie est habitée d’éléments animées, tandis qu’à l’autre bout de la pièce un brin de théâtre dont le film passe en boucle reçoit son public. Les peintures sont fixées sur des supports amovibles, regroupées en divers lieux de l’exposition. Anarchie des sujets et des styles entre eux. On y trouve le foisonnement des instants divers. Diverses histoires qui se croisent.
L’humain comme finalité, l’art comme moyen
L’art est là, comme on renoue avec des instincts absents ou dénaturés dans notre société, une société trop souvent pervertie par la consommation. Ici, c’est « gratuit », enfin je veux dire non marchand. C’est pour la santé. Le but n’est pas de concurrencer les galeries comme me le disait le Dr Granier, responsable de l’atelier d’art thérapie de Purpan, ce n’est pas l’enjeu. Le propos ici, est bien de soigner au moyen de l’art. Ce moyen n’est pas la finalité. Il permet aux malades de s’exprimer et de se sentir exister. La santé semble encore être un domaine dans lequel on pense l’Homme et son bien-être comme des fins en soi.
Aucun nom ne ressort de l’exposition. Les créations sont anonymes et pourtant singulières. Elle œuvrent à sortir les patients de la stigmatisation. Car d’ordinaire, on ne comprends pas le fou et sa différence de relation à l’autre, temporairement incompatible avec la société. Ou plutôt qui comprends encore le fou ? Cette figure archétypale d’un jeu de cartes ou fou du roi. Le mot de fou n’est plus utilisé dans le vocabulaire médical où il a été remplacé par celui de malade. Le malade, qui est touché par la maladie, le « mal à dire » si l’on prends la tangente offerte par le langage des oiseaux. Ce rapprochement est ici intéressant en ce sens qu’il exprime la difficulté rencontrée à verbaliser au moyen du langage articulé, et la nécessité du recours à une autre forme d’expression pour soigner ces maux temporairement hors des mots. Le malade devient ensuite le patient, celui que l’on soigne et qui fait œuvre de complicité avec le temps dans sa guérison. L’art thérapie peut ainsi ressembler à l’histoire de l’huitre, qui par mégarde avale un grain de sable. Ce dernier la blesse. Ne pouvant s’en débarrasser, elle se met à produire du nacre donnant naissance à la perle. C’est l’art thérapie.
Pour les visiteurs, cette exposition est un temps qui existe en dehors du geste mercantile. Un temps gratuit pour ainsi dire. Un temps passé à exprimer que nous, êtres humains, nous sommes plus qu’une donnée utilitaire, plus que des produits ou sous-produits marchands qui servent une économie. Nous sommes aussi et surtout des êtres mus par les nécessités d’une âme. J’entends par là, cet espèce de petit ou grand supplément de vie, qui fait que nos aspirations dépassent les simples données brutes du réel, du matériel, de la nécessité physique. « Enfin, l’art, le vrai » m’a-t-on dit avant que je ne vienne. L’exposition est venue à bout de mon scepticisme. C’était bien l’art, celui qui interroge et qui remue ; celui qui vient du cœur sans se soucier de la technique, et évolue librement car son seul but est l’expression. Il remue quelque chose en nous, réveille et transforme notre rapport au monde en dehors de toute logique spectaculaire et commerciale.
En sortant de là, je pense à mes pinceaux, et me dis que l’art est peut-être bien la seule maladie nosocomiale à laquelle on ne refuse pas de s’exposer ! …
Pour lire l’article, cliquez sur l’image