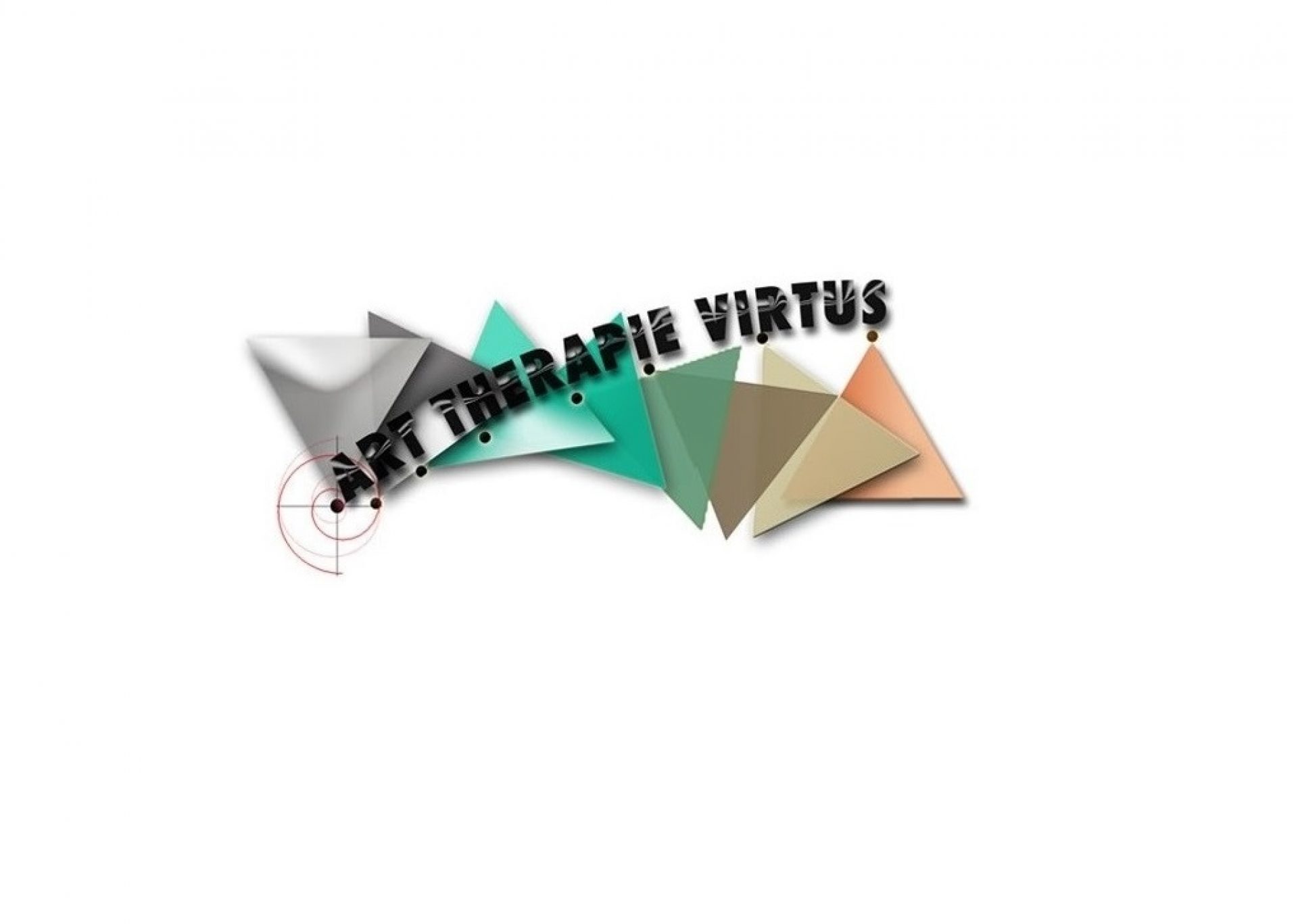Henri Maldiney est mort dans la semaine du 6 au 7 décembre 2013, à plus de cent ans.
Sa pensée irrigue nos réflexions depuis toujours. Son travail impliqué, fécond, toujours en mouvement, nous a ouverts (un de ses mots favoris) aux dimensions philosophiques de l’art-thérapie dont il a été le principal penseur.
Le matin même du 6 décembre, pendant trois heures et demi, Bernard Rigaud auteur de Henri Maldiney, La capacité d’exister (éditions Germina)faisait un cours à l’INECAT sur sa pensée à nos élèves en médiations artistiques et en art-thérapie qui découvraient – pour ceux qui ne l’avaient pas encore lu – la richesse de sa pensée.
Henri Maldiney, né en 1912, a longtemps enseigné la Philosophie Générale, l’Anthropologie phénoménologique et l’Esthétique à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Lyon. Le champ de sa réflexion concerne la psychose, l’esthétique, le mythe, la poésie, la thérapie et la vie des formes qui s’y dévoile. Il a aussi écrit sur le peintre Tal Coat, Bazaine, Cézanne et les poètes Francis Ponge et André du Bouchet.
Nous invitons fortement à la lecture de cet ouvrage, prélude à la lecture et à la méditation des ouvrages essentiels de Maldiney, entre autres : Regard, Parole, Espace, L’âge d’Homme, 1973 et 1994 ; Art et existence, Klincksieck, 1985 ; Penser l’homme et sa folie, Jérôme Millon, 1991 ; L’art, éclair de l’être, Comp’act, 1993. Existence, crise et création, Paris, Encre Marine, 2000.
On consultera avec profit le site de l’Association Internationale Henri Maldiney
http://www.henri-maldiney.org/
Nous reproduisons ici sa postface à notre livre Penser l’art-thérapie, PUF, 2012 qui reprenait avec son autorisation le texte « Le vide comme ressourcement de l’œuvre, paru dans la revue Art et Thérapie, 50/51, (La peinture au-devant de soi), 1994 Les intertitres sont de la rédaction d’Art et Thérapie
Jean-Pierre Klein
Une forme qui se signifie en se formant
Henri Maldiney
L’art ne rend pas le visible, il rend visible.
Paul Klee, Confession du créateur.
Personne ne s’est expliqué d’aussi près que Paul Klee avec le concept de Gestaltung.
Personne autant que lui n’a marqué qu’une forme n’est pas, mais qu’elle existe, qu’elle existe à frayer sa voie, dans un présent de pure instance. En 1914 il écrit dans son journal : « La genèse en tant que mouvement formel est l’essentiel de l’œuvre » (1) ou encore : « La création vit en tant que genèse sous la surface visible de l’œuvre. C’est ce quevoient rétrospectivement toutes les natures spirituelles, mais prospectivement les seulesnatures créatrices » (2). Plus tard, dans ses cours du Bauhaus, il tient le même langage en explicitant le sens de la Gestaltung. « La doctrine de la Gestaltung traite les chemins qui conduisent à la Gestalt (forme)… Le mot « Gestaltung » caractérise ce que précisément ilveut dire par sa terminaison. Gestaltung est, d’une manière absolument claire, en prisedirecte sur le concept qui est impliqué dans ses conditions sous-jacentes : le concept d’unecertaine mobilité » (3).
Prinzhorn, de même, met l’accent sur cette mobilité. On ne saurait, dit-il, donner de la perfection d’une œuvre une autre définition que celle-ci : « La plus haute intensité de viedans une Gestaltung accomplie » (4). Encore faut-il bien l’entendre. Si vitalité et perfection ont partie liée, ce n’est pas seulement en fin de partie, c’est-à-dire là où et quand la Gestaltung s’achève en Gestalt, et l’acte en état. « La fin, dit Paul Klee, n’est qu’une partie de l’essence : la manifestation (Erscheinung) ; la vraie forme, essentielle, est une synthèse de formation et de manifestation » (5). À vrai dire il n’y a pas synthèse de termes qu’on puisse considérer à part. La manifestation, par où une forme se produit à son propre jour dans l’espace qu’elle suscite, est tout aussi active que sa formation; c’est le même, pour une forme, de s’advenir, de s’apparaître (expression encore courante au XVIIème siècle) et de se signifier. C’est pourquoi Prinzhorn peut dire : « Nous cherchons le sens de chaque forme formée dans l’acte de formation lui-même » (6).
Ce sens se signifie en tant que la forme se forme, parce que la formation de celle-ci est fondamentalement expression. « C’est le besoin d’expression, dit Paul Klee, qui est aufondement de la Gestaltung » (7). De son côté Prinzhorn, traitant des « fondements psychologiques de la Gestaltung », les rapporte, de même, au besoin d’expression. Sa pensée sur ce point consonne avec celle de Ludwig Klages dont il cite en note (8) un titre caractéristique : « Aus-drucksbewegung und Gestalt-ungskraft » (mouvement expressif et énergie créatrice de formes).
Les mouvements expressifs se produisent en des occasions très diverses. « Mais il est un domaine qu’on ne peut embrasser qu’à partir de ces faits d’expression exclusivement : le règne de la Gestaltung artistique ». Radicalement différents des mouvements dirigés vers un but, les mouvements expressifs « ont la propriété d’incarner le psychique, en telle sorte qu’il nous est donné, sans médiation, dans un vécu participatif ». « Avec le besoin d’expression tout le psychique dispose pour ainsi dire d’un véhicule grâce auquel il sort de son cadre étroit limité à la personne et accède à l’espace de la vie universelle » (9).
Le besoin d’expression n’est pas un besoin parmi d’autres. Il est inhérent à la vie psychique de l’homme. Il est l’instance qu’elle se fait à elle-même, selon sa dimension propre, de se manifester. Ainsi constitue-t-il la réponse de Prinzhorn à la question liminaire qu’il pose dans le titre de son premier chapitre : « Sens métaphysique de la Gestaltung ». À cette question métaphysique Prinzhorn tente de répondre en la projetant dans le plan psychologique. « Les traits principaux d’une œuvre constituée en forme, nous croyons pouvoir déjà les mettre en évidence dans le processus de formation lui-même, ramené à ses facteurs essentiels où ils se laissent facilement appréhender à titre de fonctions psychologiques nettement définies » (10).
Or il répudie ce projet quand à la fin de l’introduction il insiste sur le « caractère phénoménologique » de sa démarche et déclare : « En dernière analyse nous aussi (comme Husserl), nous ne cherchons pas des explications psychologiques mais une intuition d’essence » (11).
Comment résoudre cette contradiction ? Nous dirons que la psychologie de Prinzhorn garde toujours sur elle l’ombre portée des questions premières, et que, à défaut du sens métaphysique de la Gestaltung, il en exprime le sens mythologique. « Mythologique » dans le sens de Freud disant « La théorie des pulsions est pour ainsi dire notre mythologie. Les pulsions sont des êtres mythiques, grandioses dans leur indétermination » (12).
Prinzhorn ne parle pas autrement du besoin d’expression : « Ce que nous désignons par-là est une poussée pulsionnelle obscure qui ne dispose en soi d’aucune forme spécifique de décharge, à la différence de la pulsion au sens strict. Elle est réduite à se servir d’autres modes pulsionnels d’expression, qui sont déjà appropriés à des réalisations de type déterminé » (13).
Ces modes spécifiques d’expression relèvent de six pulsions, poussées, tendances, besoins – le terme importe peu – qui constituent, dit Prinzhorn, les racines de la Gestaltung : pulsion de jeu, pulsion décorative, pulsion d’imitation, tendance à ordonner, besoin de symboles et… poussée de la Gestaltung (exemple vouloir dessiner). Tous ces moments expressifs sont assujettis de l’intérieur à la puissance intégrative d’un procès formateur.
Ils n’ont plein sens que là où ils n’ont rien à signifier.
La pulsion ludique
Le jeu de l’enfant, le jeu à l’état pur de l’enfant qui ne joue à rien, est l’exemple extrême de la pulsion ludique. Il ne consiste pas dans un affrontement, ni même dans une explication… avec le monde, donné en face. Il s’entretient d’une conjonction mouvante, auto-mouvante, avec l’Umwelt. L’enfant se livre, c’est-à-dire à la fois s’exerce et se confie à des mouvements : courir ça et là, tournoyer, s’élancer, se rouler, se balancer, etc., qui mettent en jeu tout son corps et qui sont autant de façons d’en appeler à… et de répondre à… l’ouverture de l’espace. Le jeu est indivisément exercice et apprentissage, mais sans souci ni savoir de ce qui est à exercer et de ce qui est à apprendre. En deçà de toute distinction de sujet et d’objet, il n’est expressif ni du moi ni du monde, mais de l’être au monde. Il ne s’éclaire d’aucune lucidité de savoir, mais d’une lucidité de puissance. L’enfant existe à son corps à même les tournures du monde auxquelles il est accordé, et il existe à quelque chose comme un monde ou pré-monde à travers les façons de son corps.
De ce moment ludique existe un équivalent parfait : Les hirondelles de Francis Ponge.
Chaque hirondelle infailliblement se précipite, inlassablement, elle s’exerce à la signature, selon son espèce, des cieux.
Plume acérée trempée dans l’encre tu t’écris vite
Ce texte a pour titre : « randons ». Or ce sont de tels randons que nous décrivons nous-mêmes, quand nous nous laissons aller à dessiner dans un état de distraction attentive, quand, par exemple, tout en écoutant une conférence ou un rapport ou les propos d’un interlocuteur au téléphone, nous griffonnons sans but des traits sur une feuille de papier.
Que se passe-t-il exactement ?
Toute chose, tout événement ont lieu sur fond de monde. Ce fond constitue la base continue de toutes nos perceptions et nous lui sommes originairement présents de par toutes les potentialités de notre corps propre. C’est en lui que nous avons notre ancrage, chaque fois que nous percevons un phénomène du monde, en particulier mouvant, comme est la parole d’autrui, et avec lequel, pour qu’il soit quelque chose, nous devons maintenir la cohérence. Or le maintien de la cohérence, à travers les changements inhérents au phénomène, exige à la fois la stabilité et le remaniement de notre système de référence. C’est à quoi justement se prêtent les griffonnages. S’inscrivant sur cette feuille de papier, nos tracés l’entretiennent dans sa fonction de support; et cette constante référence au support confère à notre conduite graphique une stabilité.
Cependant, comme il est bien connu dans le test de Rorschach, une motricité stable conduit à des réponses kinesthésiques, qui mettent le monde en mouvement. Ces kinesthésies ne sont pas quelconques. Les variations du tracé, au cours de l’écoute de l’autre, sont des modifications grâce auxquelles nous entretenons la cohérence entre notre champ marginal d’ancrage et la mobilité du phénomène perçu. Cette activité graphique est une expression partielle des potentialités qui sous-tendent notre rapport fondamental au monde. C’est en cela qu’elle est signifiante. Le degré de liberté, de rigidité ou d’automatisme de ces tracés témoigne à chaque fois du mode de notre présence au monde à travers la parole entendue.
La pulsion décorative
La différence entre les randons des hirondelles et les vôtres, quand vous griffonnez sur une feuille de papier, c’est que vos tracés, tout en se déployant sans but, tendent à s’emparer, même distraitement, de la surface. Ils s’enrichissent en y mettant votre marque. Tel est, selon Prinzhorn, le sens de la pulsion décorative. Orner un rocher de traits gravés, c’est signer une présence humaine. Mais cette présence n’est pas purement active ; elle est aussi réceptive. L’ornement révèle la tournure de son support (et celle de l’Umwelt) en l’accomplissant en présence sur un mode qui s’ajuste à lui. Ainsi va-t-il également des peintures rupestres. Ceux qui ont peint à Lascaux les cerfs nageant dans la rivière ont utilisé les arêtes et les plis fuyants de la roche, ressentis par eux comme des fibres de l’espace. Ces fibres sont conductrices ou inductrices de tracés-flux qui sont les tenseurs de l’espace pictural – de sorte que l’apparition de la rivière et des cerfs y nageant est un événement de tout l’espace : de l’espace de la grotte et de l’espace pictural que, à même ces tracés, les deux en un, nous hantons.
Mais des mouvements expressifs ne suffisent pas à faire une œuvre d’art. Pour atteindre à la « perfection formelle » une œuvre d’art et, en elle, chacun de ses mouvements, doivent remplir du même coup, deux exigences : « incarner le plus riche contenu psychique » et constituer une forme qui ne relève que de sa propre nécessité intérieure. Ce sont là deux pôles opposés. Leur opposition est celle-là même que Hölderlin requiert, en poésie, entre le ton fondamental ou signification et le caractère artistique du poème (14). Et de même que la poésie consiste dans le passage (Uebergang) ou le transport (Metaphora) de l’un à l’autre, la Gestaltung artistique, dit, lance un pont du besoin d’expression à l’œuvre, ou du vivre à la forme.
Il est plus juste, cependant, de voir dans un tel passage un procès dont la Gestaltung est l’opérateur et l’opération. De cette dualité résulte une tension polaire qui se manifeste, dans chaque composante de l’œuvre, par un écart entre sa dimension expressive et sa dimension formelle. Le même tracé ludique ou décoratif qui signifie en exprimant est une forme qui se signifie en se formant. Mais cet écart est simultanément un accord, et l’accord est d’autant plus puissant que l’écart est plus grand. Le degré de cette tension mesure la puissance de la Gestaltung qui la suscite en la surmontant, et, par-là, dit Prinzhorn, la valeur de l’œuvre.
Pour comprendre la Gestaltung, il faut la surprendre à l’œuvre. Comment s’y montre-telle ?
« Sa force s’enracine dans le champ entier de la vie psychique, en tant qu’il en émane des impulsions expressives » (15). Ce qui informe de l’intérieur ces mouvements expressifs c’est une onde modulante qui les traverse et que Prinzhorn nomme le flux rythmique. Le rythme est l’essence de la Gestaltung. Prinzhorn l’a nettement perçu, puisqu’il oppose, dans les œuvres figuratives, fonction représentative et rythme, marquant ainsi que le rythme constitue, en opposition à la dimension imageante, la dimension proprement formelle de l’œuvre, la dimension selon laquelle elle se forme, selon laquelle elle est œuvre. D’où sa conclusion : « C’est le même de dire que la puissance de la Gestaltung fait la valeur de l’œuvre et de dire que le degré d’animation rythmique d’une œuvre détermine son rang parmi tout ce qui est constitué en forme » (16).
Le processus perceptif
Malgré sa déclaration d’intention phénoménologique, Prinzhorn cherche à éclairer la Gestaltung à partir d’une explication psychologique: il l’inscrit dans le processus général de la perception. Au départ un chaos de données sensibles. Puis leur intégration en une image intuitive. C’est là la phase cruciale. Le processus d’intégration peut bifurquer dans deux directions: « Ou il aboutit, par synthèse conceptuelle des données sensibles, à une image cognitive, c’est-à-dire au sens habituel du mot, à une représentation et, de là, à un savoir d’objet; ou il tend à configurer le divers intuitionné en une image purement intuitive. Cette image, par le choix des données sensibles et par l’accentuation des traits constitutifs où manifestement les valeurs expressives jouent un rôle décisif, peut s’élever jusqu’à valoir comme une forme d’essence » (17).
La constitution d’une forme artistique ne diffère pas, par essence, de celle des autres configurations perceptives. « Il est absolument impossible de distinguer psychologiquement deux processus de Gestaltung différents: l’un physio-plastique qui s’en tiendrait à la nature, l’autre idéo-plastique qui s’en tiendrait à la représentation et au savoir » (18).
Prinzhorn en tire la conséquence: à l’extrémité de ces deux voies, il s’établit une sorte d’accord entre forme et savoir, entre rythme et concept. Cet accord est inégal. Il équivaut à la mise en tutelle de la Gestaltung artistique. Elle subit, en effet l’attraction d’une finalité qui n’a pas son terme et sa perfection en elle, mais dans le savoir.
Or l’originalité de la Gestaltung artistique implique son originarité. Précisément elle n’a pas son origine là où Prinzhorn la situe: dans le processus perceptif. Toutefois il ne pouvait en indiquer le départ, parce que la psychologie de son temps ne savait rien et ne voulait rien savoir de la sphère propre du sentir et du sens des sens. À la base de cette méconnaissance du sentir, qui caractérise toute psychologie synthétique – aujourd’hui comme hier – il y a donc ce postulat: l’expérience débute par un chaos sensible… postulat >que dément tous les jours l’éveil et l’ouverture de quelque chose comme un monde, ou d’une esquisse de monde, à même la moindre sensation. Cette situation engage la vie des formes. Pourquoi Prinzhorn refuse-t-il à la Gestaltung et au rythme d’ « être indépendant de la pulsion cognitive qui vise à un savoir » (19)? Pour garantir un sens à la forme. En quoi il a raison. Mais il se trompe sur la signifiance de la forme, sur son pouvoir d’éclairement, dont la lucidité n’est pas de savoir, mais puissancielle. La connaissance qu’une forme apporte avec soi n’est pas d’ordre gnosique, mais pathique. Or le pathique est la dimension du sentir, lequel est un ressentir – et, en cela précisément, le moment expressif de notre être au monde, en deçà de toute objectivation. Un objet peut être porteur d’une charge émotionnelle ou affective et donner de lui-même une vue pathétique postérieure à son élucidation. Un champ de tournesols perçu comme une assemblée de têtes d’or levées vers le ciel est un objet émouvant, comme aussi son image.
Son expérience est complète en soi et ne doit rien à l’art, même si elle y fait irruption.
Mais la « haute note jaune » comme dit Van Gogh, où une fois a sonné pour lui le monde, l’a atteint avant toute constitution en objet de l’étant; et en elle il a eu ouverture au monde entier. À même cette couleur-événement qui lui arrive, il co(n)naît au monde apparaissant, sur un ton déterminé. Comme la musique induit la danse, tout « sentir » induit un se mouvoir. Ici la « climatique » du monde, auquel la tonalité de ce jaune l’introduit, induit en Van Gogh une tension spécifique qui, à travers les puissances et les résistances des couleurs, de la matière, et des schémas d’images, se fait jour dans le rythme d’une forme unique : le tableau.
Qu’est-ce qui s’exprime là, en fin de compte ? Prinzhorn répond: le psychique. Ce mot vague ne fait que réifier, en termes de substance, un arrière-fond supposé de vécus de conscience. Plus obscurément mais avec plus d’acuité, il dit ailleurs que la Gestaltung aboutit à ce qu’il nomme « Wesensform » (20); une forme qui donne forme à une essence, ou dans laquelle une essence prend forme. Quelle essence? Celle du formateur. Seul l’homme est capable de Gestaltung. En cela même il est capable de soi, c’est-à-dire capable de son essence à même l’expression qu’il en donne. Ce qui s’exprime dans la Gestaltung c’est l’essence de l’homme.
Ex-ister
Or l’essence de l’homme est existence. Non pas au sens trivial, où « exister » signifie avoir une réalité comme un étant au milieu de l’étant, mais au sens indiqué par le préfixe ex – avoir sa tenue hors… L’existence diffère radicalement de tout comportement envers l’étant – envers l’étant que nous ne sommes pas et envers l’étant que nous sommes nous-mêmes.
« Nous-mêmes » disons-nous. Nous marquons par-là que cet étant, nous le sommes comme seul peut l’être un soi. Nos comportements ne sont proprement nôtres que par cette dimension qui est en eux plus originaire qu’eux-mêmes: l’être à dessein de soi. Un soi qui n’est pas donné dans le monde, fût-ce à titre de possible ou d’idéal. Tout comportement envers un étant dans le monde se déroule certes dans le monde. Mais… encore faut-il qu’un monde soit là.
Là qu’est-ce à dire ? Un schizophrène de Minkowski nous l’apprend. Assis sur une chaise, dans une salle où il est arrivé par différents couloirs, il répond à la question « Où êtes-vous ? » : « Je suis ici. Mais ici pour moi ça ne veut rien dire ». Sa parole nous signifie qu’il a cessé d’être le là, où quelque chose ou lui-même puisse avoir lieu et sens d’être.
Pourtant il est capable de nommer tout ce qui l’environne et de décrire son itinéraire. Il occupe une place qu’il peut localiser. Mais il ne s’y trouve pas. Il ne s’y découvre pas soi. Et il n’est pas au monde. Être au monde, c’est être chez soi sous l’horizon d’une contrée à laquelle nous avons ouverture et dont nous sommes le là. Être soi, de même, est autre chose que de figurer à une place particulière parmi les étants. Un être déterminé par leurs configurations, qui se recoupent en lui, est un être fait. C’est ce qu’exprime le schizophrène quand il dit qu’il est aux mains des autres, sous une forme persécutoire. La persécution marque ici la violence faite à un être qui s’éprouve désapproprié de son propre, court-circuité de l’être à dessein de soi.
Que l’on songe à cette situation, au sens propre innommable, d’aliénation essentielle : être pu! On entreverra par contraste qu’exister en tant que soi, c’est se pouvoir. C’est être son propre pouvoir-être, lequel n’est pas de l’ordre de l’étant, lequel, au regard de l’étant, n’est rien. Un soi n’est pas. Il est à être. « Deviens ce que tu es. Mais tu ne l’es qu’à le devenir ». L’existence implique des moments critiques où elle est mise en demeure de se pouvoir ou de disparaître. Ces moments sont des failles. Des vides qui sont à franchir, des déchirures dont le « jour » n’apparaît que dans le franchissement.
La Gestaltung exprime l’existence. Mais celle-ci n’étant rien de donné, son expérience n’est pas un reflet ni l’extériorisation d’un état préalable de pure immanence. La Gestaltung est un mode de l’existence elle-même, selon lequel celle-ci se met en oeuvre.
Son essence, à elle aussi, est existence, par cela qu’elle est rythme. « Il n’est pas d’oeuvre, du moment qu’elle est forme, qui ne soit animée par le rythme ».
Le rythme est directement expressif de l’existence en ce qu’il comporte des moments critiques, dans la faille desquels il s’expose au risque de se transformer en… lui-même ou de s’abolir. Un rythme ne peut être perçu à titre d’objet, même formel. Il ne peut qu’être existé – procès dans lequel, comme dit Rilke, « rythmiquement je m’adviens » (21).
Le vide
Par-là s’éclairent le sens et la portée existentiels des oeuvres graphiques, plastiques ou picturales des malades. Elles ne sont pas de simples traductions – reflets de leur état habituel, de leur déréliction. A tout le moins elles l’expriment et, par-là même, l’outrepassent. Faire oeuvre c’est dans la même mesure, se faire être. L’acte de dessiner implique une certaine précession de soi, par où le malade est partiellement porté à soit dans l’éclaircie de son pouvoir-être. En présence d’une surface à peindre ou d’un bloc à sculpter, où il a à intervenir alors que tout est encore indécidé, il est en présence d’un Rien, vide qui appelle à faire et où il a à être. Cet espace de jeu entre la feuille de papier et lui est soustrait à la fatalité des déterminations quotidiennes. C’est une clairière vide où cesse l’astreinte de l’étant. Dans une telle situation, si précaire soit-elle, « ici » commence à vouloir dire quelque chose… quelque chose d’ignoré.
Ce vide s’éprouve sur des modes divers qui peuvent être d’angoisse ou de refus. Mais, tel qu’il se manifeste dans les griffonnages les plus inhibés, cet espace de jeu constitue un premier degré d’indépendance par rapport à l’entourage obsidional. Si, selon l’expression de Pierre Schneider, « la vie est une faute d’orthographe dans le texte de la mort » (22), le Rien est une déchirure dans la trame de l’étant, dont il s’agit d’apercevoir le jour pour avoir ouverture au monde et à soi. C’est là que se montrent dans les oeuvres des malades, alors même qu’elles attestent un certain pouvoir-être, les déficiences de l’existence en échec.
Quel défaut en elles en est la marque? Un défaut par excès. Ce qui leur fait défaut, c’est l’Ouvert, sous la forme du vide et du Rien. Les oeuvres des schizophrènes – quelle qu’en soit la variété – manifestent la compacité de l’étant auquel ils sont jetés, eux-mêmes étants. Elles montrent la contrainte où ils sont de ne pas laisser être le vide. Mais quel vide ? et pourquoi ?
Il est normal d’éprouver le vide comme risque. Nous avons notre tenue dans le Rien parce que nous n’ex-istons qu’au risque d’être, au risque d’être soi ou de ne pas être soi.
Ce risque peut être éprouvé comme menace sans écart… si justement tout est joué, et si ce vide est d’avance colmaté par le retour fatal du même. La compacité de l’étant est la marque de toute psychose. Tous les moments critiques de l’existence sont réduits à un seul, répétitif, dont s’entretient la plainte mélancolique ou le thème délirant d’un schizophrène. Si le mélancolique dit ne pouvoir rien, ne vouloir rien, n’être rien, et demande seulement qu’on ne lui demande rien (23), le Rien dont il souffre est un néant étant, non l’endurance de l’Ouvert.
Le dynamisme d’une forme ne suffit pas à définir la Gestaltung comme genèse. La dimension selon laquelle une forme se forme est son rythme. Prinzhorn rapporte la Gestaltung au besoin d’expression. Elle exprime l’ex-istence, au sens non trivial.
Existence et rythme impliquent des moments critiques, des vides. Ce sont ces vides qui font défaut à l’existence psychotique et dont le manque se décèle dans les oeuvres des malades.
Le vide actif est précaire. Mais nous l’avons vu s’exprimer d’une manière particulièrement expresse dans l’activité artistique d’un schizophrène, à l’atelier de peinture du Centre Social, à l’hôpital psychiatrique du Vinatier. Cet homme ne peignait que des fleurs. Une seule par tableau. Il le faisait en deux temps. Il peignait d’abord la corolle, la tige et le fond, laissant en blanc, vide, la place du calice. Puis il allait à la fenêtre et fumait une cigarette en regardant au-dehors, dans le vide. Ensuite il revenait à sa peinture et remplissait le vide, réservé, d’une couleur en contraste harmonieux avec les autres. Ce vide au coeur de l’oeuvre, que doublait, plus diffus, ce vide à la fenêtre, signifiait pour lui quelque chose, comme une absence. Mais c’est parler trop vite que d’évoquer une absence de moi. Bien plutôt s’agissait-il d’un appel au vide à dessein de soi. C’était un vide en attente, le rien d’un pouvoir-être indécidé, indécidable.
A être, à la fin recouvert, s’est-il aboli? Non, car à travers les couleurs du tableau final régnait une tension faite d’échanges réciproques, que les Chinois nomment mutations et dont ils disent justement qu’elles ne sont possibles que grâce au vide.
Par contre le manque, dans une peinture ou un dessin, de vides actifs où le rythme se ressource, marque un échec à être soi. Car un soi n’est pas une déterminité locale dans l’ensemble conditionné de l’étant. Il existe à l’avant de soi, à la pointe du Rien.
L’acuité de la Gestaltung, de l’autogenèse des formes, perpétuellement instantes à soi dans l’être-oeuvre d’une oeuvre, dévoile où l’auteur de l’oeuvre en est de lui-même. Telle est la signification existentiale de la Gestaltung que Prinzhorn a pressentie et dont la quête, à la fois inspirée et méthodique, confère à son oeuvre une lucidité que n’ont pas encore bien saisie l’esthétique et la psychiatrie d’aujourd’hui.
Du vide à la création C’est au moment du détachement que devient possible une création. La précession de soi est essentielle dans l’acte de création. Quand on dit qu’on s’exprime dans une oeuvre d’art, cela est un leurre total car ce serait dire ce qu’on était avant. Or, faire oeuvre c’est exister, à travers l’oeuvre, en avant de soi. L’oeuvre dépasse son auteur. La création, c’est créer au-dessus de soi. L’oeuvre est une quête du soi qui n’est pas là d’avance : il n’est qu’à l’état de possibilité. L’oeuvre est un événement qui ouvre un monde en nous transformant. La conquête du soi consiste en devenir autre et non pas revenir au même.
Il s’agit non pas de maintenir le soi mais de devenir le soi. Comme le dit Héraclite, ceux qui mènent le cortège de Dionysos ne se rendent pas compte que Dionysos et Hadès, c’est le même.
Il faut partir de l’informe comme le dit Winnicott dans Jeu et réalité mais la question n’est pas de systématiser l’informe (« la synthèse est toujours gouvernementale« , écrit Proudhon).
Quels sont les moments où on rencontre le sans forme ? L’adolescence se complaît aux extrêmes lointains. Ses projets ne sont pas des projets mais des représentations.
L’imaginaire c’est le ressac de l’imagination. L’imagination est dépassement, transcendance, présence au-delà de soi, ex-istence. C’est de la non-existence que l’existence peut commencer, dit un proverbe chinois. Une oeuvre existe en côtoyant son vide dans lequel elle plonge dans la mesure où elle en est issue. Dans notre existence aussi, il est certains moments où on se ressaisit en même temps qu’on se sent saisi par cette extase d’en bas. La « transpassibilité » est une réceptivité à ce qui est hors d’attente, au rien.
Celui qui ne s’abîme pas au rien n’est pas créateur. Un soi qui se sait d’avance, c’est un personnage, ce n’est pas une personne. Le vide est le lieu de ressourcement de l’oeuvre.
L’histoire est ouverte, elle ne se donne pas une idée de l’oeuvre à faire.
Au fond, l’existence procède ; c’est là seulement que quelque chose peut être.
(1) Klee P. – Tagebücher, s. 314, Nr 934
(2) ibid – s. 313, Nr 932
(3) Klee P. – Das bildnerische Denken. p. 17
(4) Prinzhorn H. – Das bildnerei der Geisterkranken. p. 15 – 1922, Berlin
(5) Klee P. – Das bildnerische Denken. p. 21
(6) Prinzhorn H. – Op. cit. p. 15
(7) Klee P. – Das Bildnerische Denken. p. 17
(8) Prinzhorn H. – op. cit. p. 16 und 354
(9) ibid. – p. 17
(10) ibid. – p. 15
(11) ibid.. – p. 11
(12) Freud S. – « Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung » in der Psycho-analyse. 1932, s.w. XV 101
(13) Prinzhorn H. – op. cit. p. 18
(14) Hölderlin – « Ueber den Unterschied der Dichtarten » in Sämtliche Werke. s. 889 sqq., 1970, Darmstadt
(15) Prinzhorn H. – op. cit. p. 48
(16) ibid. – p. 49
(17) ibid. – p. 42 – 99
(18) ibid. – p. 47
(19) ibid. – p. 43
(20) ibid. – p. 42
(21) Rilke M. – Sonnets à Orphée, Atmen
(22) Schneider P. – A voix vive
(23) Textes inédits du Prof. Dr Roland Kuhn (Munsterlingen – Schezingen)