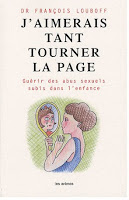page 58
page 58Lorsque tout fonctionne bien, chacun a conscience de soi, c’est-à-dire de son corps, de certains aspects de sa personnalité, de son histoire, de ses actes, ainsi que du monde extérieur, c’est-à-dire des autres êtres vivants, de son environnement et de la société dans laquelle il vit.
Cette conscience s’accompagne de souvenirs, de sentiments, de sensations et de connaissances qui sont contrôlés par ce que nous appelons le « moi ».
Il permet à notre psychisme de fonctionner d’une manière harmonieuse, c’est-à-dire comme un ensemble unifié et cohérent (j’ai conscience de mon existence dans ce monde, de mon identité, de mon histoire).
Pour être pleinement conscient de notre identité, nous avons besoin de notre mémoire (quelqu’un d’amnésique ne sait plus qui il est) et de notre aptitude à percevoir le temps qui passe, c’est-à-dire les notions de passé, présent et futur.
Grâce à notre sens de l’identité, nous sommes conscients de rester le même malgré nos différents changements physiques, psychologiques et sociaux dans le temps.
Dissocier signifie « séparer des éléments qui sont associés ».
Le mot « dissociation » est souvent utilisé seul ; mais nous devons le comprendre comme « dissociation des fonctions habituelles de la conscience », condensé en « dissociation de la conscience ».
Lorsqu’une fonction est dissociée, elle n’est plus sous le contrôle du moi et devient plus autonome. Soit elle ne répond plus aux sollicitations du moi, soit elle s’exprime sans que ce dernier n’en fasse la demande.
Les fonctions qui peuvent être dissociées sont :
• la mémoire (perte de la mémoire, c’est-à-dire amnésie totale de certains événements ou d’une période précise de la vie, ou au contraire surgissement de souvenirs indésirables),
• le contrôle des mouvements volontaires (paralysie d’une partie du corps ou apparition de mouvements incontrôlés),
• le sens de l’identité (perte du sens de l’identité ou expression de plusieurs identités différentes),
• et les sensations (anesthésie d’une partie du corps ou perceptions inhabituelles).
Soulignons que ces symptômes sont d’origine psychologique, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas liés à des maladies organiques.
La dissociation de la conscience implique une rupture de son fonctionnement harmonieux et adapté aux situations vécues.
…/…
Le moi, à un moment donné, devient incapable d’assurer la collaboration des différentes parties du psychisme vers un but commun (dans ce cas, avoir une relation sexuelle épanouie). Certaines parties (la mémoire et les sensations) font sécession, reprennent leur autonomie et s’expriment de manière indépendante, comme si elles se retrouvaient libérées du contrôle supérieur de la conscience.
______________________
Autres billets sur J’aimerais tant tourner la page de François Louboff
1/ J’aimerais tant tourner la page – Guérir des abus sexuels subis dans l’enfance
2/ Le rôle de la justice dans le statut de victime
3/ L’argent et les victimes de viols par inceste
4/ Enfant d’incestée
6/ La dissociation est un moyen de défense du psychisme
7/ Qu’est-ce que la PE – partie émotionnelle – après un traumatisme
8/ Qu’appelle-t-on « PAN » – partie apparemment normale après une dissociation
9/ Les enfants – de victimes de viols par inceste – présentent un risque de SSPT trois fois plus important que dans la population générale
10/ Quand être victime devient une addiction
11/ Explications psychologiques de la revictimisation
12/ La fibromyalgie et le syndrome de fatigue chronique
13/ Les souvenirs traumatiques : un autre type de mémorisation
14/ La dissociation traumatique perturbe la mémorisation
15/ L’altération de la mémoire autobiographique