En revanche, je garderai longtemps le souvenir du mélange de fascination, de peur, de mépris, de haine et d’immense désespoir que je ressentirai lorsque je le retrouverai mort, à Nantes, vingt ans plus tard…
page 25
J’ai de plus en plus peur de mon père. Il le sent. Il le sait.
J’ai tellement besoin de ma mère, mais comment faire pour lui parler ? Et que lui dire ? Que je trouve le comportement de mon père bizarre ? Je me tais.
Un soir, à Tarbes, mon univers bascule dans l’horreur. J’ai dix ans et demi.
Les enfants se taisent parce qu’on refuse de les croire.
Parce qu’on les soupçonne d’affabuler.
Parce qu’ils ont honte et qu’ils se sentent coupables. Parce qu’ils ont peur.
Parce qu’ils croient qu’ils sont les seuls au monde avec leur terrible secret.
De ces humiliations infligées à l’enfance, de ces hautes turbulences, de ces descentes au fond du fond, j’ai toujours resurgi. Sûr, il m’a fallu un sacré goût de vivre, une sacrée envie d’être heureuse, une sacrée volonté d’atteindre le plaisir dans les bras d’un homme, pour me sentir un jour purifiée de tout, longtemps après.
page 42
Un après-midi, je fugue pour fuir mon père. Je n’en peux plus. Je marche, je marche, je marche. Je décide d’aller à la gendarmerie. Le gendarme m’écoute attentivement, j’ai même l’impression qu’il me croit. Mais il m’explique que je ne suis pas majeure et que je dois retourner chez mes parents !
C’est mon père qui vient me rechercher. Il laisse entendre que je suis une malade, une « affahulatrice ». Il me ramène à la maison, je le hais. Je suis punie pendant plusieurs jours, mais je sens que ma démarche l’a frappé.
page 49
Quand je suis petite, je suis déjà longue et maigre. Puis, à dix ans, rondelette ; à vingt ans, grosse d’avoir traversé tant d’avanie, comme pour me matelasser et me protéger contre celles encore à venir. Le chagrin ne nourrit pas, mais fait grossir.
page 57
Je suis partie pour Bruxelles en train afin de me rendre chez un cousin très éloigné qui, lors d’un passage « à Vitruve », m’avait laissé son adresse en Belgique. Il dirigeait un orchestre de balalaïkas et savait que je voulais chanter. Il m’a hébergée durant deux mois. Tandis qu’il me cherchait du travail, je faisais son ménage, tenais sa maison où il recevait beaucoup de monde, des gens qui ne me plaisaient pas du tout. Il me versait quelques sous. J’attendais. J’espérais.
Une nuit, je suis allée l’écouter. Ses musiciens arboraient de très amples chemises en satin rouge avec de larges manches très resserrées aux poignets. Ils étaient bottés de cuir noir. Lui, cheveux gommés, chemise de satin violet, botté de rouge : c’était le chef ! Je n’ai pas gardé un souvenir ébloui de cette soirée. Quelques jours plus tard, il m’a confié que jouer de la balalaïka était le versant artistique de sa vie. De l’autre côté, il avait des activités moins musicales, mais beaucoup plus lucratives.
Peu à peu, il est devenu méchant, brutal. Un après-midi, je me suis enfuie avec mes quelques sous, profitant de ce qu’il était absent.
Plusieurs jours durant, je me suis cachée ; j’avais très peur qu’il me fasse rechercher. J’ai toujours eu peur de qui porte un uniforme. Et peut-être encore plus peur de qui fait le même métier sans en porter.
Mais j’avais tort de m’inquiéter, ce n’était pas un angoissé, Sacha Piroutsky ! Jamais il n’a cherché à apprendre ce que j’étais devenue.
page 59
Je franchis donc le tourniquet de l’hôtel et fonce droit vers le portier. Je lui explique mon histoire, que je romance un brin. Il me questionne, me prie d’attendre puis revient, tout sourire. Je l’ignorais, mais il a toujours existé dans les palaces des « dames de luxe », des « femmes-divan » chargées du délassement des hommes d’affaires ou autres notabilités de passage. Le portier propose de me faire prêter de l’argent pour m’habiller, réparer « mon yeux », puis de m’installer dans une très belle chambre et, ma foi, vu que je n’ai pas l’air sotte…
– Merci bien, mais ce n’est pas mon truc…
Plutôt une petite chambre que je paierai plus tard, que je promets de rembourser très vite, ça oui…
Ce soir-là, je dors dans des draps après m’être détendue avec plaisir dans un bon bain. Merci, monsieur le portier ! La chambre est à mes yeux un palais.
Page 60
…/… Je signe des notes qui s’allongent. Au bout d’un mois, la direction de l’hôtel se manifeste très normalement. Le portier me réitère sa « très gentille proposition ». On commence à me refuser mes plateaux, puis mes cafés. J’ai faim.
Un soir, je descends dans la rue pour me prostituer. Ce n’est pas le malheur, le grand malheur ; mais c’est un grand chagrin.
Pour de l’argent, pour manger ou pour élever un enfant, par amour pour un « mec », pour payer sa « dope », rarement par vice, c’est ainsi que ça commence.
Ce métier-là, j’aurais aimé le faire comme un sacerdoce, un vrai don de soi. Donner de l’amour. Je l’ai écrit : Je suis une petite sœur d’amour, hop-là !… Etre petite sœur d’amour, chanter, prendre le voile, tout ça, c’est du pareil au même. Sauf que chanter, monter sur scène en pleine lumière, revêtue de son habit de scène, c’est faire montre d’un grand égocentrisme et d’une belle indécence.
Il est vrai que c’est toujours une chose merveilleuse que de gagner sa vie en faisant métier de ce que l’on aime. Longtemps, ça ne m’a pas plu de gagner de l’argent tout en chantant. Chanter, pour moi, c’était « prendre le voile », « sacraliser ». Après, j’ai mieux compris…
Page 105
Un taxi m’a conduite à l’adresse donnée par sœur Jeanne. C’est un café, au coin d’une rue. J’entre ; quatre hommes jouent aux cartes ; l’un d’eux s’avance vers moi, me prend doucement la main :
– Vous êtes la fille de Monseigneur ?
– Nous aimions beaucoup votre père.
Un homme à lunettes, monsieur Paul s’approche à son tour, un peu agressif. Longtemps ils me parlent d’un homme extraordinaire dont ils ne savent rien, sinon qu’il avait été rejeté par sa famille, qu’il avait eu quatre enfants qu’il aimait, une fille, surtout, qui chantait.
De quoi vivait-il ?
Où habitait-il ? Parfois il dormait dehors, mais il réapparaissait au matin, impeccable, pour entamer d’interminables parties de poker. Gai, généreux, gueulard, il ne croyait en rien, n’espérait plus rien.
– Jamais une plainte, confirme monsieur Paul. Pourtant, une fois qu’il avait un peu trop bu : « Je suis allé trop loin, c’est fini pour moi », aurait-il dit à monsieur Paul qui proposait de l’aider. Monsieur Paul raconte ; j’écoute, bouleversée, la vie de cet homme que je n’ai pas connu et dont je retrouve pourtant des traits de caractère. Je m’en veux d’être arrivée trop tard. J’oublie tout le mal qu’il m’a fait, et mon plus grand désespoir sera de ne pas avoir pu dire à ce père que j’ai tant détesté : « Je te pardonne, tu peux dormir tranquille. Je m’en suis sortie, puisque je chante ! » Peut-être a-t-il longtemps et partout traîné le souvenir et le remords de son crime ? J’apprends que les appels mystérieux reçus à la maison, quand on raccrochait chaque fois sans rien dire, c’était lui. La musique revient dans ma tête. Monsieur Paul dépose devant moi un vieux portefeuille, une paire de lunettes dont les verres sont rayés.
– Si j’avais su… , dit-il, oui, si j’avais su que vous étiez comme ça, je vous aurais quand même appelée, mon petit. Je l’insulte, lui crie que c’est nous qui avons été abandonnés, que ma mère a vécu un calvaire, que moi-même…
– Je comprends… , dit monsieur Paul qui ne peut pas comprendre mais qui a été si formidable.
– Pardonnez-moi. Vous avez bien fait de respecter ses volontés. Je vous remercie. De quoi est-il mort ?
– Un soir que la partie s’était prolongée tard, il a été pris, au moment de partir, d’une très violente douleur dans les reins.
J’apprends que, ne sachant pas où il allait dormir, il coucha, ce soir-là, chez monsieur Paul. Au matin, il refusa de voir un médecin, mais, la douleur persistant, il finit par accepter d’être transporté à l’hôpital. Comme on lui demandait où il fallait quérir ses affaires, il répondit en rigolant qu’il ne possédait que ce qu’il avait sur lui. Il mourut trois semaines plus tard, d’une tumeur cérébro-spinale, refusant même la morphine qui aurait adouci sa fin.
Merci, monsieur Paul !
Page 109
J’entre, ma mère est allongée sur le petit divan, les traits tirés, inquiète. – L’enterrement… C’était l’enterrement… Je tombe. Je raconte sans tout dire, sachant que l’apparente indifférence de ma mère masque un vrai chagrin. Mais je ne peux réprimer par moments mon agressivité, malheureuse de ne pas être aidée, comprise, et, tout à coup, je vouvoie ma mère ; je lui parle comme à une étrangère, peut-être pour pouvoir raconter avec plus de distance.
Elle ne comprend pas très bien ce qui se passe; aucune d’entre nous deux ne relèvera ce tournant, mais nos rapports seront à jamais changés sans que je puisse préciser clairement ces modifications. Je deviendrai sévère à l’égard de ma mère que j’ai toujours adorée, même si j’ai eu tant de mal à l’aimer. De son côté, elle manifestera envers moi, qu’elle dit indomptable, les premiers et timides élans d’une maman qui vient de découvrir son enfant. Elle deviendra elle-même mon enfant chérie que j’assumerai, protégerai toujours et du mieux que je pourrai.
Page 119
Vivre, je veux vivre avec la même violence que j’ai eue parfois à vouloir mourir sans vraiment mourir, à attendre la nuit pour m’y endormir bellement.
Page 122
Et toujours, les allées-venues de H… Il revient, il repart. Il m’écoute fredonner et propose de revenir définitivement si je ne chante plus. Jaloux. Possessif. Terrible. Il va se battre contre un piano, contre des chansons, contre un public peu nombreux mais qui constitue déjà ma raison de vivre.
Non, non et non !
Alors, séparation définitive.
Déchirure.
Rémusat de soleil et de glace.
Rémusat gris cendre…
Rémusat qui n’avait été aménagé que pour un seul amour mais qui revient trop tard, quand je n’en veux plus d’avoir eu tant mal, trop mal du temps d’amour.
Page 127
Le lendemain, on me parlera beaucoup de cette chanson. Elle sera longtemps source de confusion. On m’a souvent crue nantaise ! Non, je ne suis pas du tout nantaise ! J’ignore pourquoi mon père avait choisi cette belle ville pour y terminer sa vie. Plus tard, lorsque je partirai en tournée et que j’arriverai à une centaine de kilomètres de l’estuaire de la Loire, je serai prise d’une sorte d’étouffement. Il me faudra longtemps avant de pouvoir entrer calmement dans Nantes. Chaque fois, je vais au cimetière en cachette pour y déposer des fleurs. Ce n’est que beaucoup, beaucoup plus tard que je confierai aux journalistes la véritable histoire de Nantes.
Page 137
J’ai aimé la rencontre avec les hommes de ma vie, la dualité, la complicité, le rire, la quiétude, la séduction, l’impérieux besoin de reconquérir chaque matin, de rêver une vie à deux tout en sachant parfaitement que rien ni personne ne résisterait à mon piano, à mes théâtres, à la route partagée avec d’autres.
J’ai couru, attendu, retrouvé, perdu, aimé, aimé, heureuse, cruelle aussi, implacable souvent.
Cet état d’amoureuse, je l’ai presque toujours connu. J’en avais besoin pour chanter.
Dans ma vie de femme j’ai échoué.
Dans ma vie de mère j’ai échoué.
J’ai longtemps senti dans mon ventre un vide glacé, j’ai longtemps jalousé les femmes enceintes et détesté les nouveau-nés. J’ai souvent marché la main posée sur mon ventre.
Aujourd’hui, je pense que c’était sans doute le prix à payer et que ma vie a été malgré tout belle et intense.
Page 155
Ce séjour hospitalier m’apparaît comme une parenthèse de douceur. Je n’assume plus personne. Je me laisse porter ; sans culpabilité. J’ai envie d’écrire.
Page 167
D’ailleurs, le fou rire peut en un instant tout balayer, dédramatiser, ramener les choses à leur juste valeur – le problème, c’est qu’il lui faut trouver la place de se glisser dans mes colères. Or j’excelle à tout barricader, à m’enfermer à triple tour, à me rendre étrangère à mon interlocuteur qui me devient alors lui aussi parfaitement étranger ; je me mets brusquement à vouvoyer un ami et un complice de dix ans et plus, et je ne peux même plus imaginer que nous nous soyons fréquentés plus de cinq minutes dans toute notre vie. Ma colère, que je trouve invariablement justifiée, qui jamais ne résulte de quelque caprice, est toujours un moment où le paroxysme me porte, où une douleur ou une violence me tourmente à tel point que je m’y noie, hurlant à l’injustice, avec le sentiment de ne pas être entendue dans mon entière bonne foi et mon exigence de vérité.
Page 188
J’ai reçu tellement d’amour, tellement ! Et toute cette énergie qui m’a fait avancer, chanter, qui m’a permis de faire ce métier comme j’entendais le faire : en désobéissant, en refusant tous les archétypes, en ayant un instinct de préservation qui m’a toujours empêchée de me perdre dans le compromis, la confusion.
Joël JULY a publié en décembre 2004 aux PUP une étude sur le style de Barbara intitulée Les Mots de Barbara.
__________________
Autres billets sur Barbara
Barbara : Lecture analytique de l’introduction d’ Il était un piano noir … – mémoires interrompus – de Barbara
L’aigle noir par Philippe Grimbert
« l’Aigle noir » ou l’impair d’un père par Philippe Grimbert
Les amours incestueuses interprétées par Barbara
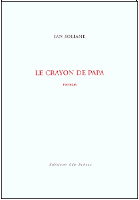 « …L’inceste, Ian soliane en raconte l’effroi, en montrant comment le rapport haine-amour pour le bourreau, détruit la conscience de la victime qui se sent parfois même coupable. L’auteur, qui a vécu tout cela enfant, a dédié ce livre à sa soeur qui passa aussi entre les mines d’un crayon paternel souillé par l’infamie. Pas d’effets, pas de passages scabreux, l’écriture de l’auteur refusant toujours la complaisance suggère, au lieu de monter de façon salace. Et Ian Soliane de composer une ode au pardon possible, qui n’est pas synonyme d’oubli, mais qui permet de renaître à la vie et donc aux autres. Nécessité absolue, en fait, pour ne pas sombrer dans la destruction de son âme. Le crayon de papa est un grand livre, admirablement composé, avec un épilogue stupéfiant qui serre la gorge et qui, dénonçant l’inceste, redit aux victimes qu’un avenir meilleur est possible. Un livre chrétien en fait, au sens biblique du terme, où l’écriture s’affirme contre un rempart à la folie, au suicide et à la mort. Un livre d’écrivain. Un écrivain lucide, généreux, compassionnel.
« …L’inceste, Ian soliane en raconte l’effroi, en montrant comment le rapport haine-amour pour le bourreau, détruit la conscience de la victime qui se sent parfois même coupable. L’auteur, qui a vécu tout cela enfant, a dédié ce livre à sa soeur qui passa aussi entre les mines d’un crayon paternel souillé par l’infamie. Pas d’effets, pas de passages scabreux, l’écriture de l’auteur refusant toujours la complaisance suggère, au lieu de monter de façon salace. Et Ian Soliane de composer une ode au pardon possible, qui n’est pas synonyme d’oubli, mais qui permet de renaître à la vie et donc aux autres. Nécessité absolue, en fait, pour ne pas sombrer dans la destruction de son âme. Le crayon de papa est un grand livre, admirablement composé, avec un épilogue stupéfiant qui serre la gorge et qui, dénonçant l’inceste, redit aux victimes qu’un avenir meilleur est possible. Un livre chrétien en fait, au sens biblique du terme, où l’écriture s’affirme contre un rempart à la folie, au suicide et à la mort. Un livre d’écrivain. Un écrivain lucide, généreux, compassionnel.


