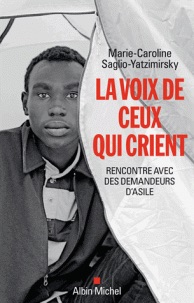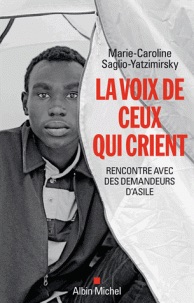 Migrants en détresse psychologique : « Je reçois des patients hantés par des cauchemars »
Migrants en détresse psychologique : « Je reçois des patients hantés par des cauchemars »
Par Charlotte Boitiaux Dernière modification : 18/01/2019
La psychologue clinicienne Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky, qui exerce à l’hôpital Avicenne, à Bobigny, en région parisienne, vient en aide aux demandeurs d’asile et migrants traumatisés par leur exil et en grande détresse psychologique. Elle reçoit des patients psycho-traumatisés, pour qui la demande d’asile devient souvent un parcours quasi-impossible.
InfoMigrants :
Les personnes que vous recevez en consultations vivent des « traumas complexes ». Pouvez-vous nous expliquer ?
Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky :
Ce sont des patients qui subissent généralement plusieurs violences.
Ces personnes subissent en premier lieu la violence d’avoir quitté leur terre natale, leur qualification, parfois leur statut social. Vient ensuite la violence de la route de l’exil, puis la violence de la vie dans les pays d’arrivée, souvent dans la rue ou dans des campements insalubres.
Lors de mes consultations, je travaille beaucoup sur la séparation, puisque je parle à des pères de famille, à des mères de famille, qui parfois ont laissé leurs enfants pour partir.
Il y a accumulation et répétition des violences et la plupart du temps, ces personnes vivent cette « dégradation » généralisée comme quelque chose de mortifère.
Je reçois donc des patients hantés par des cauchemars. Des personnes qui n’ont pas l’impression de vivre dans le présent parce qu’elles sont constamment happées par la violence du passé. Des personnes qui ont tous les symptômes de la dépression : isolement, pensées noires, pensées suicidaires, perte d’appétit, perte d’énergie, perte de sommeil, parce les images de la violence reviennent en permanence.
On sent chez eux une anxiété généralisée. Ce sont des patients qui me disent : « Je ne peux rien faire… On est le matin, et je ne peux rien faire parce qu’il n’y a plus rien à faire. »
Certains arrivent à tenir psychologiquement parce que, par exemple, il faut envoyer de l’argent à la famille, il faut donner des nouvelles. Mais pour d’autres, c’est plus dur.
InfoMigrants :
La prise en charge de ces migrants en détresse psychologique arrive-t-elle trop tard ?
Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky :
Toutes les enquêtes s’accordent à dire qu’il faut une prise en charge rapide. Or, oui, elle arrive trop tard.
C’est très dur de traiter un trauma quand le médecin arrive deux ans après les faits. Le trauma s’est enkysté et le patient vit avec une monstruosité dans sa tête.
Un quart des personnes en camps auraient besoin de voir un psychiatre, ou sont dans un état de détresse psychologique très important. Il faut faire quelque chose.
Un pays qui reçoit mal, c’est un pays qui ne favorise pas l’intégration, l’accueil.
InfoMigrants :
Les personnes à la rue dépressives peuvent-elles se soigner seules ?
Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky :
Pour soigner ses blessures psychiques, le meilleur moyen reste la consultation doublée d’une médicamentation – quand elle s’avère nécessaire.
Mais avec la population migrante, avec les demandeurs d’asile, le problème est différent. Nous sommes face à des personnes qui ne connaissent pas le système de santé français. Elles ne savent pas qu’il existe des consultations pour soigner les maladies psychiques.
Alors, les personnes à la rue ont adopté des stratégies pour éviter de sombrer. Beaucoup de patient nous disent qu’ils restent avec leurs amis, qu’ils ne s’isolent pas. C’est important de parler de choses et d’autres à plusieurs. Il faut pouvoir transformer le traumatisme en expérience collective.
D’autres se tournent vers la religion. Ils estiment ainsi que ce qui leur arrive ne dépend pas d’eux, mais d’une force supérieure.
InfoMigrants :
La procédure d’asile devient-elle difficile quand on est en détresse psychique ?
Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky :
Oui, quand on est dans un campement sauvage, quand on va mal, quand on a des troubles psychiques, demander l’asile, c’est dur. D’une part, parce que le système est complexe, d’autre part, parce que parler devient impossible.
La particularité en France, c’est que la demande d’asile est entièrement basée sur la parole. Il faut pouvoir faire son récit devant l’Ofpra ou la CNDA [cour d’appel du droit d’asile]. C’est le récit qui va vous permettre d’obtenir une protection ou non. C’est un immense paradoxe pour les personnes victimes de stress post-traumatique !
Pourquoi ? Parce que Les personnes en stress post-traumatique souffrent de troubles cognitifs, c’est-à-dire que leur mémoire n’est pas fiable. Il y a une confusion dans la tête. On a des patients qui ne se souviennent pas de la date de naissance de leurs enfants…
Remettre des dates, refaire une chronologie peut être très difficile. Le trauma bouleverse tout ça.
Puis, il est impossible de demander à des personnes qui ont subi des violences intimes, comme des viols, des viols collectifs, des viols intra-familiaux, de raconter leur histoire devant un inconnu. Je reçois par exemple des femmes en consultation qui me disent clairement : « Je ne raconterai jamais ça ».
Autre problème, certains patients, notamment ceux ayant subi des violences politiques, me racontent que les entretiens de l’Ofpra s’assimilent, pour eux, à des interrogatoires policiers. C’est la même configuration : la petite pièce, le petit box, la chaise qui fait face à un agent.
Ce sont des situations anodines pour nous mais qui, pour eux, vont les empêcher de parler. Il faut donc pouvoir faire comprendre ses souffrances, sans les exprimer.
C’est une réflexion qui, je crois, est entrée dans les réflexions de l’Ofpra. Les agents de protection prennent de plus en plus en compte les psycho-traumas pour « améliorer » les entretiens. Il faut prendre en compte le fait que des demandeurs d’asile ont une psyché bouleversée.
InfoMigrants :
Avez-vous un conseil pour les migrants déprimés, coupés du monde médical ?
Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky :
Quelqu’un qui ne va pas bien doit comprendre qu’il a besoin d’aide. Il doit appeler à l’aide. En France, il peut se rendre à l’hôpital, dans les services d’urgence. Il peut se rendre dans les PASS, aussi.
Il doit le dire à un tiers, une autre personne, qui peut l’emmener à l’hôpital.
Quand quelqu’un sent que ça bascule, il peut aller dans n’importe quel hôpital en disant que ce ne va plus du tout. Il y a suffisamment de ressources dans un pays comme le nôtre pour qu’on puisse faire quelque chose.