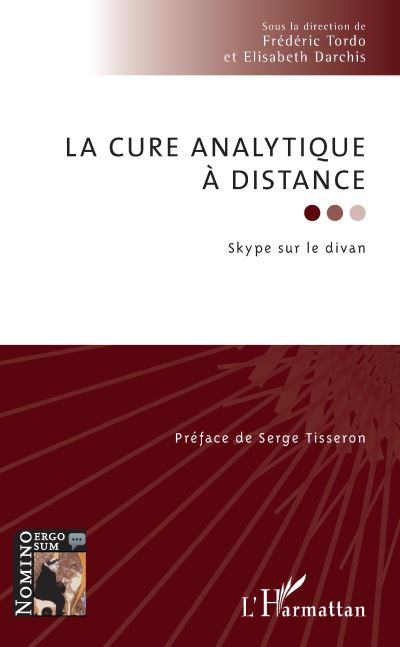Le virtuel soigne pour de vrai
Pour vaincre les phobies ou dépister un trouble mental, la médecine a de plus en plus recours à l’immersion dans la « réalité virtuelle ».
Par Pascale Krémer
28.11.2008 à 18h25
Une petite pièce peinte en noir, traversée par deux barres blanches. En leur centre, un cerceau. Le patient, qui s’est glissé dans le cercle, porte un casque avec écran intégré à hauteur des yeux, dont s’échappent deux antennes, capteurs qui détectent ses mouvements de tête. Lentement, souris d’ordinateur en main, il chemine dans une ville virtuelle. Dès qu’il avance, l’image, recalculée en temps réel, respecte son point de vue. L’illusion est parfaite. Il a l’impression de marcher, lui qui ne sort plus de chez lui depuis des mois, terrifié à l’idée de tomber. A tel point qu’avec la souris, il trébuche, au début, lorsqu’il doit enjamber un trottoir un peu haut. Et qu’il rase aussi les murs dans ce monde numérique.
A l’extérieur de la pièce, devant son ordinateur, la psychologue lui suggère de se placer au milieu de la rue. Elle voit ce que son patient voit, peut l’entendre, lui parler, surveiller ses constantes physiologiques. Comment se sent-il ? Peut-il évaluer son niveau d’anxiété, sur une échelle de 0 à 10 ? Qu’il n’hésite pas à lui parler, surtout, si certaines images, certains souvenirs affluent… Peut-il compter les arrêts de bus ? Moment de panique. La voix le rassure. Il ôte le casque, sort du box de réalité virtuelle, regagne tranquillement le bureau de sa thérapeute.
Science-fiction ? Non, vraie consultation à l’hôpital parisien Pitié-Salpêtrière, dans le service du professeur Roland Jouvent, psychiatre, qui dirige également un laboratoire du CNRS, le « centre émotion ». Grâce à la réalité virtuelle, cette représentation informatique du monde en trois dimensions dans laquelle l’homme est immergé avec la possibilité d’interagir, le professeur Jouvent évalue et traite des patients phobiques. Ceux qui ont peur de marcher, notamment, qu’ils soient atteints d’affections neurologiques, de maladies psychiatriques, ou simplement âgés et déjà tombés.
Fausses araignées, vraie peur
« On leur fixe des objectifs pour qu’ils se concentrent sur autre chose que sur la marche, commente Natacha Box, psychologue. C’est un outil de la thérapie, ce n’est pas la thérapie elle-même : je m’entretiens avec les patients avant, pendant, après. Mais la réalité virtuelle offre un support pour l’imaginaire, et les patients voient très vite leurs progrès, donc reviennent. » Un outil qui fonctionne presque trop bien. La confiance acquise dans cette virtualité immersive se transporte dans la réalité. Par sécurité, avant de retourner dans le monde réel, les patients joueront à un jeu vidéo qui sollicite tout le corps afin de reprendre conscience de leurs limites.
Différents environnements virtuels (une ville, une île montagneuse, un château, un pont) permettent, à la Salpêtrière, de venir à bout des troubles anxieux : l’agoraphobie (peur des espaces publics peuplés), l’acrophobie (vertige), l’arachnophobie (peur des araignées)… Un tiers des patients phobiques est désormais traité de la sorte, et la liste d’attente ne cesse de s’allonger. Ludique, la méthode suscite l’engouement, y compris chez les personnes âgées pourtant peu coutumières des mondes numériques.
Sophie, 31 ans, fréquente le box de réalité virtuelle depuis la fin 2006. « Je souffrais d’agoraphobie suite à une lésion cérébrale. J’avais des problèmes de repérage spatial, du mal à me déplacer dans les grands espaces, au milieu de la foule, une sensation d’enfermement dans les lieux clos. Je ne sortais pratiquement plus de chez moi. » Elle dit avoir retrouvé aujourd’hui son autonomie, et s’apprête à reprendre le travail. « Dans le box, on est placé dans une situation de tous les jours. Cela ne m’aurait servi à rien de parler de mes angoisses de façon abstraite. »
Les assurances remboursent
Evoluer dans un univers numérique spécialement conçu pour traiter tel ou tel trouble : les Américains ont compris depuis le début des années 1990 tout l’intérêt thérapeutique de la virtualité immersive, de cette cybermédecine d’avant-garde. Tandis que les chirurgiens commençaient à peaufiner leur technique en réalité virtuelle, des psychologues ont eu l’idée de s’emparer de ce matériel pour traiter la phobie des hauteurs. Succès. Et première publication en 1995, dans l’American Journal of Psychiatry.
Dans la foulée, des cliniques du virtuel, spécialisées dans le traitement des troubles de l’anxiété, voient le jour. Il en existe une dizaine, aujourd’hui, qui ne désemplissent pas : Virtually Better, à Atlanta ; ou le Virtual Reality Medical Center, installé à San Diego, dans plusieurs autres villes de Californie et de Floride, et même à Bruxelles depuis 2006. Par immersion dans la réalité virtuelle, on y traite toutes les phobies spécifiques (la peur de l’avion, des ascenseurs, des orages, de l’école, des seringues et du sang…) ainsi que les phobies sociales, comme la peur de parler en public. Et même le stress post-traumatique des soldats revenant de la guerre d’Irak ou d’Afghanistan, en les faisant évoluer dans des images évocatrices de petites rues bondées, de fouilles de maisons, de convois attaqués… « Nous avons déjà mené 7 000 sessions de thérapies, assure le docteur Brenda Wiederhold, présidente-fondatrice du Virtual Reality Medical Centre. Nous enregistrons 92 % de succès, alors qu’en psychologie, souvent, il faut compter avec 15 à 20 % d’abandons en cours de traitement. Surtout, il y a un transfert dans la vraie vie des compétences acquises. La preuve : la plupart des assurances remboursent le traitement… »
Angoisse, addiction, anorexie
D’autres champs d’application commencent à être explorés. Le traitement de la douleur (lors des chimiothérapies ou des soins aux grands brûlés), grâce au grand pouvoir distractif de l’immersion dans l’image. Le traitement des addictions (alcool, tabac, marijuana), en développant les capacités d’autocontrôle du patient plongé dans un environnement où les tentations sont nombreuses.
• Au Québec, le laboratoire de cyberpsychologie de l’université de Gatineau met au point les univers virtuels qu’utilisent les cliniques canadiennes spécialisées dans les troubles anxieux. Il s’intéresse également à l’addiction aux jeux et au dépistage des déviances sexuelles.
• En Italie, on traite virtuellement les troubles de l’image du corps qui génèrent anorexies et boulimies.
• En Israël, on aide les enfants autistes à entrer en communication avec autrui…
• La France, en cette matière virtuelle, n’est pas franchement pionnière. Au pays de la psychanalyse reine, les thérapies cognitivo-comportementales (il est possible de « désapprendre » au patient les comportements et pensées qui posent problème), susceptibles d’utiliser cet outil, peinent à se faire une place.
La frilosité des médecins est grande, aussi, face à ces nouvelles technologies qui nécessitent de travailler avec des techniciens, de s’associer à des industriels, qui prennent du temps, ne correspondent à aucun acte coté par la Sécurité sociale, et sont un peu vite assimilées à l’univers réputé dangereux des jeux vidéo.
Et qui coûtent cher surtout. Divers programmes de recherche clinique, français ou européens, ont fait pénétrer la réalité virtuelle à l’hôpital, au début des années 2000. Sans suite une fois la recherche finie, faute de moyens. Mais voilà que les matériels se miniaturisent, devenant bien moins onéreux. Qu’ils se perfectionnent aussi, réduisant le décalage entre mouvements réels et mouvements de l’image, donc le malaise (cinétose) pouvant être ressenti par le patient. Que les logiciels de soin commencent à circuler de pays en pays, parfois gratuitement.
Depuis peu, le monde médical français a donc commencé à s’emparer de la virtualité immersive. Prudemment. Il est encore davantage question d’outil diagnostic que de traitement en tant que tel. Ici, une première start-up se lance dans le domaine du matériel de réalité virtuelle adapté au soin. Là, des chercheurs développent des environnements numériques adaptés. Comme Evelyne Klinger, dont le laboratoire Présence et innovation (de l’Ecole nationale supérieure d’arts et métiers, Ensam) conçoit, à Laval, des cuisines et des supermarchés virtuels. Ou Isabelle Viaud-Delmon, neuropsychologue, chargée de recherche au CNRS.
A l’Institut de recherche et coordination acoustique/musique (Ircam, en collaboration avec l’Institut national de recherche en informatique et automatique), elle a mis au point « Dogphobia », un monde spécialement dessiné et sonorisé pour ceux que les chiens terrorisent. Variant selon les mouvements du patient, le son est spatialisé, « ce qui est très efficace pour accroître l’impression d’immersion, donc l’émotion », note-t-elle, un rien cruelle. Les phobiques, coiffés de visiocasques, devront parvenir à maîtriser leur peur pour s’approcher, dans l’image, de dobermans aux grognements aussi réalistes que menaçants. Car c’est ainsi, en thérapie comportementale et cognitive, qu’on s’attaque aux troubles anxieux. Par l’exposition progressive à l’objet phobique, dans l’imagination, puis dans la réalité, tout en apprenant des techniques de relaxation.