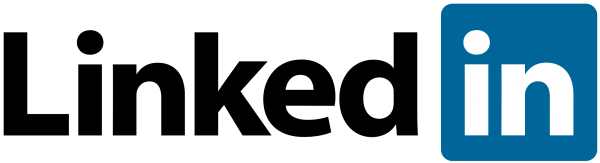 Je ne sais pas si je surmonterai un jour les attentats
Je ne sais pas si je surmonterai un jour les attentats
Par Grégoire Orain
J’ai passé près de deux ans à repousser sans cesse ce moment. Par pudeur. Par douleur. Jusqu’ici, je me contentais de m’imaginer en écrire quelques lignes, quelques mots, dans les semaines qui suivaient chaque attentat. Mais ce soir, je sais que je ne pourrai plus y échapper.
Dans ma tête, ce texte commençait invariablement par une longue liste d’excuses. Car après tout qui suis-je pour oser revendiquer une part de souffrance ?
Qui suis-je, comparé à la victime, au proche de la victime, à sa famille, à son fils ou à sa fille, à sa mère, à son père ?
Qui suis-je, comparé à celui qui a survécu, et dont aucun mot ne pourra restituer la terreur qui l’a habité, un soir de novembre ou de juillet ?
Personne.
Je ne suis pas une victime des attentats. Je ne suis pas un proche d’une victime.
Je suis journaliste, mais je n’étais pas au Bataclan.
Je n’étais pas non plus à Nice, à Saint-Etienne-du-Rouvray ou ailleurs.
Je n’étais nulle part puisque je ne vais jamais nulle part.
Je suis secrétaire de rédaction.
Mon travail, c’est de relire les textes des rédacteurs. Un petit maillon dans la chaîne de la relecture, et, le 13 novembre 2015, un minuscule rouage, précaire, dans la grande machine du Monde.
Je marche dans la rue avec mon amie. Nous sortons d’une soirée au restaurant, à Paris, et pour une fois, mon téléphone est resté dans ma poche. Ma mère m’appelle.
« Ton père est au Stade de France.
– Ah. Ben d’accord. Pourquoi tu me racontes ça ?
– Tu n’as pas vu ? »
Mon père va bien, et pourtant ma vie bascule.
Le plus dur, c’est quand on arrête de travailler
Ce n’est pas un renversement immédiat. Il y a le choc, bien sûr. Le fait de suivre, hagard, le direct de BFM-TV. Celui de lire compulsivement les centaines de mails que s’échangent immédiatement mes collègues pour s’organiser, partager des informations, se coordonner. Les dizaines et les dizaines de sms, d’alertes, de tweets qui envahissent toute la soirée, qui nous détachent du sol et nous projettent dans une réalité alternative, où plus rien n’existe sinon les morts et les témoignages, les sources proches du dossier et les gyrophares. Je relis les récits, les synthèses, les témoignages, les nécrologies. J’en sortirai deux semaines plus tard, vidé d’avoir voulu être là, d’avoir voulu aider mes collègues, d’avoir voulu me sentir moins inutile que je ne l’étais.
J’imagine que tous les journalistes qui ont couvert les attentats le diront : le plus dur, c’est quand on arrête de travailler. Mon amie, qui est aussi journaliste, surmonte les évènements avec une force que je ne lui connaissais pas. Moi, j’ai les jambes qui flanchent et je suis perpétuellement au bord des larmes. Je ne sors presque plus. Je passe chaque trajet en métro dans un état de nervosité extrême. Autour de moi, au travail, personne n’évoque ce qu’il ressent. On se demande comment on va, bien sûr, mais tout le monde répond la même chose : mal. Et si tout le monde va mal pour la même raison, alors pourquoi devrait-on en parler ?
Nous sommes tous épuisés, et les chefs le savent. Ils nous donnent un numéro à joindre si nous le souhaitons [1]. Je réfléchis, j’appelle. La première chose que je fais, c’est de m’excuser. La structure ne propose que des rendez-vous téléphoniques, et le bâtiment où je travaille est suroccupé. Il n’y a aucun endroit où je peux m’isoler à part la cage d’escalier. Je fonds en larmes, une fois, deux fois ; des collègues gênés se pressent de monter les marches en faisant semblant de ne rien voir. Je ne sais pas quoi dire, sinon que j’ai peur, que je n’en peux plus d’avoir peur, que la peur ne part pas.
Mon interlocutrice me propose des exercices : m’imaginer, pendant plusieurs minutes, que ma peur se réalise, que je suis réellement victime d’un attentat. Pleurer, tant qu’il le faut. Mais m’imaginer toute la scène, jusqu’au bout, jusqu’à ma mort. Et recommencer le lendemain.
Nerfs à vif
Ces scènes, ces fantasmes de mort, je vis déjà avec. Dans ma tête, je redéroule sans cesse les anecdotes que les collègues s’échangent à la pause. Telle victime est morte chez elle, parce que le mur n’a pas empêché les balles de la frapper. Telle autre a tenté de se cacher derrière une voiture, mais il n’y a que le bloc moteur qui peut arrêter un tir. Chez moi, j’imagine des balles faire exploser les vitres. A chaque pas, je me dis que la voiture garée le long du trottoir va exploser. A chaque station, qu’un homme armé entre dans la rame. Quand je suis assis à mon poste, que je vais voir mes collègues mourir quand des terroristes attaqueront les locaux. Je surveille tout et tout le monde. Mes nerfs sont à vif. J’entends tout. Le moindre claquement de porte me paraît suspect, la moindre sirène me noue l’estomac. Et des sirènes, à Paris, fin 2015, il y en a partout.
Ce que me demande la voix au téléphone, je n’en ai pas le courage, et j’ai honte de me sentir mal. Alors je mens. Oui, je l’ai fait. Oui, ça va un peu mieux. Et très vite, on me dit de ne rappeler que si ça va vraiment mal.
Et comment pourrais-je prétendre que je vais vraiment mal ? Les autres, eux, vont vraiment mal. Ceux pour lesquels on a fait un mémorial. Leurs proches. Ceux qui en ont réchappé, comme ma collègue qui aurait dû aller au Bataclan, mais a revendu ses places au dernier moment. Ou cette personne, sur Twitter, qui, un soir de Noël où je travaille, vient me trouver pour me dire, sans rancune, sans reproches, que l’un de ses meilleurs amis est encore à l’hôpital, et qu’elle regrette que l’on parle tant des morts et si peu des blessés. Qu’est-ce que ma faiblesse par rapport à tant de tristesse ? Rien.
J’essaie d’en parler, au moins à mon père. Au téléphone, il me répond : « Si tu le vis aussi mal, tu as mal choisi ton métier. » Je me dis qu’il a raison.
Interdiction de tourner la tête
On est en juin 2016, et je me persuade que je vais mieux. J’ai toujours peur, bien sûr, mais la peur est un bruit de fond, un bourdonnement insistant, mais léger. Parfois, quand je prends le métro ou que je vais au cinéma, le bourdonnement est un peu plus fort, mais c’est tout. Et puis, un soir, avant de m’endormir, une notification. Magnanville. Le lendemain, sur le chemin du travail, le bourdonnement s’est mué en un long cri, lugubre et permanent.
Tout recommence. Je suis toujours au Monde, mais mon travail a changé. Maintenant, je suis chargé de mettre à jour la page d’accueil du site. De choisir les titres mis en valeur, de s’assurer qu’ils sont justes, que les photos sont récentes, que le bilan est à jour, que le live est en place. Que la home tient. Qu’elle est propre. Un travail qui demande une concentration constante, de la réactivité, et de bien suivre ce qui est dit dans nos articles. Une tâche qui, en somme, me force à regarder ce qu’il se passe, et m’interdit de tourner la tête. Contrairement à beaucoup de mes collègues, j’ai pu échapper aux images et aux vidéos des attaques, qui tournent partout. Mais l’espace d’un instant, sur Twitter, j’ai aperçu l’une des photos de l’intérieur du Bataclan et des corps qui y sont étendus, envoyée par un énième « patriote » qui fétichise les photos atroces. Cette photo ne m’a jamais quitté depuis.
Je ne peux plus prendre le métro sans lutter avec moi-même pour ne pas sortir toutes les deux stations.
Juillet 2016. Pour l’Euro de football, la mairie de Paris a installé un écran géant à quelques centaines de mètres de mon appartement. Les supporteurs sont partout dans les rues, crient, boivent, chantent, lancent des pétards, mais moi, je suis soulagé, parce que c’est bientôt fini et que je ne vais plus m’imaginer qu’ils se font faucher par une arme d’assaut en plein jour. Et puis Nice arrive. Le cri est revenu. Le bruit des pétards me terrorise.
En septembre, j’ai emménagé dans un nouvel immeuble, à quelques pas de La Belle Équipe où je sais que je n’irai jamais. Chaque soir, le claquement du portail en fer de la résidence voisine me fait sursauter. Deux personnes tentent de forcer ma porte d’entrée alors que je me trouve, seul, dans l’appartement. Je les fais fuir. Je passe un mois à rêver que des terroristes viennent me chercher chez moi.
En décembre, j’ai géré tellement d’attentats que le travail est devenu un automatisme. Photo des secours le matin, photo des policiers le midi, photo des hommages le soir. Je me dis que je me suis endurci. Attentat de Berlin. Je fais une crise de panique dans un cinéma, devant ma famille. J’ai honte.
En juin 2017, j’assiste à un concert en plein air, aux États-Unis. Il fait beau, la pelouse est agréable, je me laisse bercer par la guitare. C’est là que ça me vient : je n’ai pas peur. J’avais oublié ce que ça faisait. Quand je pose le pied dans l’aéroport, au retour, le bourdonnement revient immédiatement.
Août. Je n’ai pas changé de métier, mais j’ai changé de rédaction. L’antenne espagnole aimerait que des journalistes de chaque pays parlent, dans une courte vidéo, de la façon dont on surmonte un attentat.
Je ne sais pas si je surmonterai un jour les attentats.
[1] Une décision que critiquera Aude Lancelin, dans son essai Le monde libre (2016, éditions LLL pp.165–166) : « L’orgie émotionnelle devint permanente. (…) Le Monde libre n’hésita d’ailleurs pas à dépêcher un psychologue dans chacune de ses rédactions, auprès duquel les journalistes pouvaient venir s’épancher à la demande. On admirait sa propre bonté dans les larmes des autres (…) »